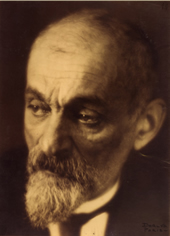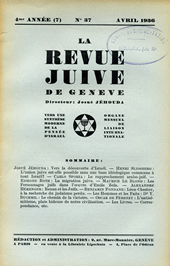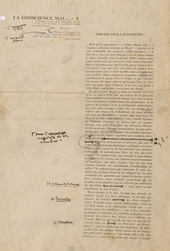Benjamin Fondane - Mémorial de la Shoah
- Les années Roumaines:
de Jassy à Bucarest - Benjamin Fondane
et les avant-gardes - Un théâtre sans décor
- Benjamin Fondane
et le cinéma - L'oeuvre poétique
- La philosophie
d'un irrésigné - L'Ecrivain devant l'histoire
La philosophie d’un irrésigné
« Je suis devenu philosophe pour défendre
ma poésie » n’a cessé de répéter
Fondane. Lors de sa rencontre avec Léon Chestov,
philosophe russe existentiel, Fondane, fraîchement arrivé
de Bucarest, n’est pas encore philosophe. Il se sent une affinité
avec la pensée de Nietzsche qu’il connaît
à travers l’œuvre de Jules de Gaultier.
La rencontre avec Chestov lui révèle combien les questions
esthétiques qui le préoccupent occultent une dimension philosophique. Dès lors, Fondane tente de faire connaître la pensée
de son maître tout en élaborant sa propre philosophie.
Au centre de la pensée de Chestov se situent la relation de l’homme
à Dieu, la lutte contre les évidences de la raison, le problème
de la liberté et du mal.
De 1934 à 1938, Fondane note l’essentiel de leurs entretiens
qui seront publiés de façon posthume sous le titre de
Rencontres avec Léon Chestov (1982).
Qu’a retenu Fondane de cet apprentissage ardu, placé sous
le signe d’une amitié exigeante?
Mots sauvages
Une critique radicale de la raison et de l’héritage grec qu’il
confronte à la Bible, devenue pour lui un texte philosophique existentiel
; et la conscience aiguë que la philosophie a confondu les lois du
savoir avec celles de l’être, en ignorant le réel et
l’existant. Les concepts philosophiques ont menti, mais voilà
que les mots, le matériau même de la poésie, n’ont
pas moins failli. « Mots sauvages », la préface de 1930
à son recueil de poésie roumaine Paysages, révèle
l’ampleur de ce désastre.
Dès lors, il s’élève contre la philosophie des
philosophes et conteste ses méthodes. À la veille de la guerre,
sa critique de l’idéalisme et de la raison devient une révolte
contre l’anéantissement qui s’annonce, car le néant
n’est que le produit d’une « raison devenue folle »
comme l’affirmera son article de 1939 « L’homme devant
l’Histoire ou le Bruit et la Fureur ». En somme, la philosophie
ne doit pas rassurer l’homme, mais l’ébranler dans ses
convictions.
L'irrésignation
De 1932 à 1944, Fondane tient aux Cahiers du Sud une chronique
régulière intitulée « La Philosophie vivante
» où d’importants articles philosophiques sont publiés.
Certains sont repris dans La Conscience malheureuse (1936) : une
série d’essais consacrés à Nietzsche,
Gide, Husserl, Bergson, Freud, Kierkegaard, Heidegger et Chestov.
Dans sa préface, Fondane invente le terme d’ « irrésignation
» pour désigner sa révolte contre la philosophie traditionnelle
qui enjoint l’homme à se résigner devant les évidences.
Pour lui, la philosophie est « l’acte même du vivant »
plutôt qu’une réflexion ou une spéculation. L’irrésignation
est un refus d’accepter ce qui apparaît comme impossible.
Le Lundi existentiel et le Dimanche de l’Histoire (1945, posthume)
peut être considéré comme un texte fondamental où
Fondane situe sa propre pensée existentielle vis-à-vis de
la nouvelle pensée « existentialiste » (Camus,
Sartre, Heidegger), tout en se réclamant de Chestov,
de Kierkegaard et de Kafka.
La mort prématurée de Fondane prive le débat entre
la pensée existentielle, telle qu’il la conçoit, et
l’existentialisme sartrien de l’après-guerre, d’un
opposant de taille.
Si c’est dans son œuvre poétique que l’empreinte
du judaïsme est la plus visible, ses textes philosophiques en témoignent
également : ni pratique, ni observance, c’est une exigence
spirituelle, une force d’insoumission.